La rêverie, comme genre littéraire, apparaît au devant de la scène avec Les Rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Jean-Jacques constate l’échec de l’entreprise des Confessions : il n’est pas parvenu à fixer son « moi ». Après l’autobiographie, dont il invente au passage la forme canonique, il pratique une écriture de soi plus libre, où les analyses de moments vécus se dédoublent d’analyses philosophiques. Écriture de soi, passages poétiques, essai, le tout dans une forme mouvante qui cherche à rendre le divers et le flux du réel. Voilà la rêverie dont il propose une forme qui deviendra elle aussi « canonique », avec ce paradoxe que c’est justement une forme faite pour n’entrer dans aucun canon.
Plusieurs enfants sont issus de cette forme. Le flux de conscience, par exemple, en reprend les codes, en rendant les syncopes plus violentes. Le danger est celui de l’abstraction, de l’expérimentation qui tourne à vide (critique de type populiste qu’on fait aux romans modernistes, mais qui souvent ne tient pas dès qu’on lit réellement) : quand on plonge dans le flux et le divers du réel, on voit bien son chaos, son absence de sens, rétif par nature à l’idée qu’on se fait d’une oeuvre d’art ou d’une oeuvre philosophique, qui devrait être ordonnée. Face à ce danger, plusieurs méthodes ont pu être mises en place, très diverses les unes des autres, mais qui sont toujours passées par le retour à l’objet : dans les cahiers de Valéry, dans la méthode de Ponge, ou dans celle de Jacques Réda (l’objet presque unique étant alors Paris).
Je songeais à cela en allant au travail, et je lisais alors Les Ruines de Paris de Jacques Réda. J’ai lu d’autres livres de Réda, mais celui jamais attentivement, alors que c’est visiblement son plus célèbre. Je tombe sur ce texte (page 17) :
« Il vient de pleuvoir abondamment pendant quelques minutes, et tout est frais. L’averse continue d’enjamber les toits vers les banlieues, ample comme une jeune fille relevant ses jupes pour mieux courir. Au bout de chaque trouée dans les murs, des arbres se repomponnent. Partout des magasins et des cafés-tabac transparents montrent la pierre du dix-septième siècle remise à neuf, tandis qu’ailleurs le staff, autour des fenêtres qu’on barricade, accable des cours bourrées de caisses jusqu’au portail. Les rues tergiversent, décrochent, favorisant des angles pour la conversation et le commerce des comestibles: petits pains russes, vin du Carmel, saucissons écarlates qui portent l’estampille en hébreu du Grand Rabbinat de Paris. Ce que l’on voit par les fentes saisissantes des palissades ne change jamais: c’est l’ortie impériale des noirs renfoncements de l’enfance, mais aussi la pelleteuse géante et jaune d’or en travers dans le ciel, comme une drague expédiée par une vague sur des rochers. Au fond de l’air mobile et mouillé qui reste bleu les boulevards font écluse, puis de la République à la Bastille partent dans tous les sens comme verticalement vers l’avenir. »
Chez Réda, la rêverie se transforme en balade urbaine. Même fondation littéraire, même travail de la syncope (ce terme, Réda le reprend au jazz, qu’il admire particulièrement et dont il transfère certains codes dans son écriture), mais en apparent hors-de-soi : l’objet de la rêverie n’est pas l’esprit, le soi, mais la ville. La rêverie est néanmoins raccourcie, ciselée, de manière à construire un poème : Jacques Réda est de toute évidence un auteur de poèmes en prose, ce que suggère tout au moins son édition (en l’occurrence, Poésie/Gallimard).
J’arrive au collège avec trente minutes d’avance et, comme je suis actuellement dans ma séquence sur la ville, je balance la séance prévue, copie le texte de Réda, y ajoute quelques questions sur les personnifications, les images perçues dans la ville, le rythme, pour aboutir à la question : en quoi est-ce un poème ? Les 4e ont des réponses plus simples que les nôtres, nous qui avons la tête théorique : il y a des figures de style, c’est joli, il n’y a pas de message ni d’histoire. Problème réglé.
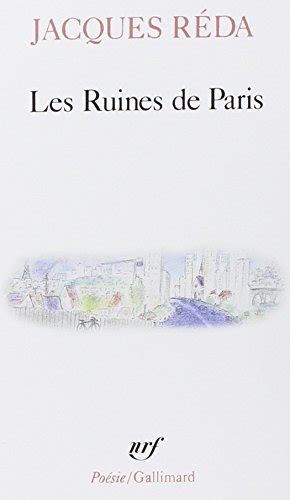
Le midi, entre le repas, la préparation du devoir commun, les corrections, je repense à mon projet au long cours d’écrire sur la ville de Bellegarde, un texte plus long que La Forme d’un fleuve qui avait eu un peu de succès ici. J’ai fait beaucoup de brouillons, mais rien d’enthousiasmant. J’écris alors ceci :
« Swing. Pas de temps. Rien qu’un instant. Marchant pour prendre l’air un instant d’air frais. Devant l’église une grande affiche : « Jésus nous attend toujours. » La librairie, la banque, l’épicerie. Au bout, le bar à vins à la droite duquel gît une boîte à livres. Lecture de Jacques Réda. Comment écrire sur une ville moyenne, terne, grise, « ville porte », en cours de gentrification, amiantée ? Personne n’y reste longtemps, sauf par obligation. Jeunes cadres ou ouvriers frontaliers (Suisse) qui mettent de côté avant d’acheter dans un lieu moins bétonné. Le Rhône coule. J’y prends de jolies photos : sur les réseaux, les gens croient momentanément que je vis dans un bel endroit. Question de cadre. De quoi me plaindrais-je ? Tant sont bien plus à peindre (à plaindre ?) Vers le vert. Dans le gris. Labyrinthe. Pas de Minotaure, donc pas de victoire : juste le labyrinthe. »
